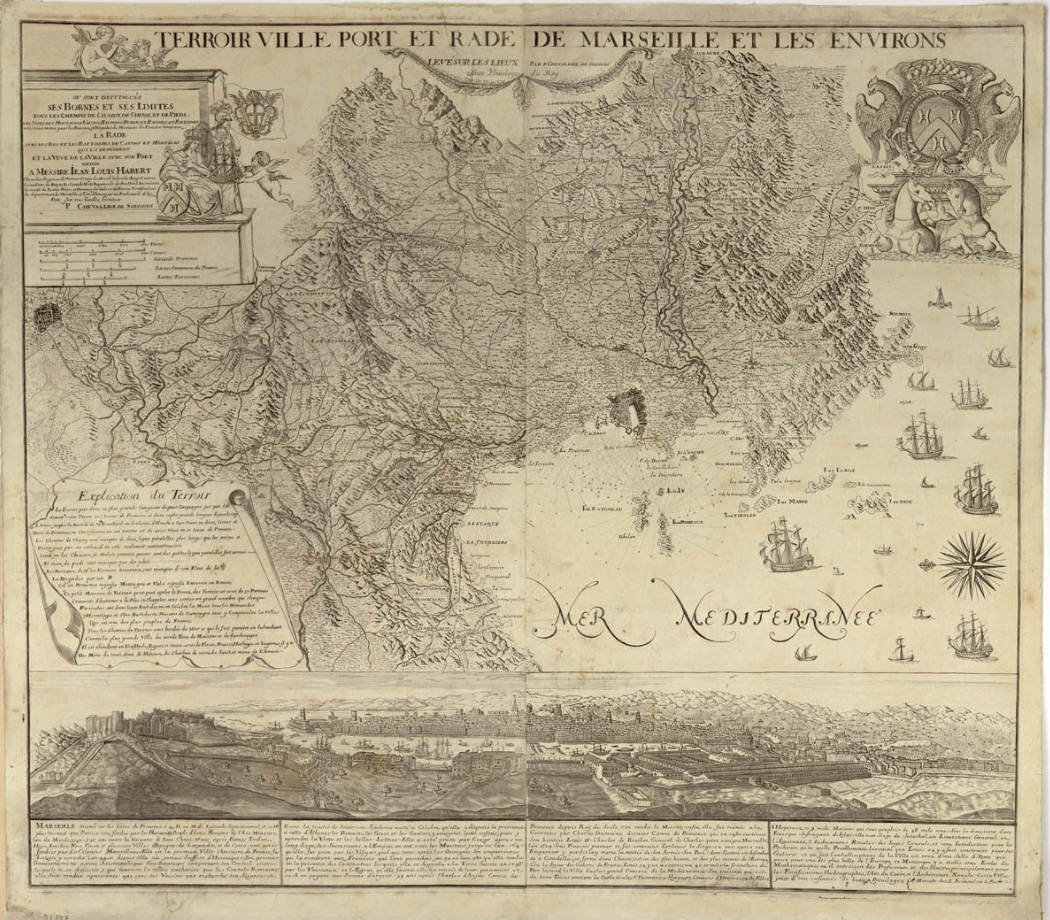A partir de la dernière décade d’août, la peste avait éclaté dans le terroir et, à la mi-septembre, elle avait déjà réalisé une terrible progression. La peste accomplissait là les mêmes ravages que dans la ville intra-muros où la mortalité ne baissait toujours pas. Ceux qui avaient fui cette dernière ou bien étaient sortis de leurs bastides désormais pleines des cadavres de leurs proches, s’étaient installés sous tentes aux abords des villages et des hameaux. A Saint-Marcel, le marquis de Forbin lui-même avait dû brutalement quitter son château pour se retirer « avec un seul valet dans une cabane en haut de la montagne », car « c’étoient presque toujours les domestiques imprudents et indociles qui portoient la peste dans les compagnies enfermées », commentait le Père Giraud. « C’est pourquoi, celles qui se gardoient soigneusement, ne les perdoient jamais de veue ou les tenoient fermés sous la clef, il n’y avoit guère [aussi] de meilleur parti à prendre » Aussi n’y avait-t-il plus une cabane, fut-elle misérable, qui n’eut été infectée, ajoute-t-il avec peut-être un peu d’exagération, et certains erraient dans les champs ou s’en retournaient en ville pour chercher une retraite.
Des inspecteurs généraux parcouraient les villages et les domaines à cheval pour obliger les paysans à aller ouvrir des fosses hors les remparts ou bien à apporter de la paille aux hôpitaux et aux Chartreux où l’on préparait le logement des troupes dépêchées d’urgence par le pouvoir royal pour secourir enfin Marseille. Ces inspecteurs en étaient souvent réduits à manger au milieu d’un champ un morceau de pain et un oignon qu’on leur jetait.
Le 24 septembre 1720, désespérés, tenaillés par la faim, les Marseillais pensaient ne plus pouvoir survivre à l’épidémie ; ils attendaient la mort, chacun à leur tour, pour être délivrés de leurs souffrances. Dans le terroir, démunis aussi bien de secours médicaux que de secours spirituels, les urbains réfugiés comme les ruraux continuaient de s’en remettre aux emplâtres de thériaque (Publication # 29) et aux bûchers prophylactiques au sujet desquels avaient été rédigés nombre de traités entiers. Toutes les herbes aromatiques des collines avaient déjà été brûlées et le moindre petit fagot coûtait désormais une fortune.
Pichatty
« Le 24 septembre, dans le temps que la misère et la calamité sont à leur dernièr période ; que tout gémit ; que tout soupire ; que tout se meurt, tant à la campagne qu’à la ville ; que ceux que la fureur du mal épargne, tombent dans la faim & dans le désespoir, plus cruels et plus redoutables que la peste même ; que les forces de la charité qui ont coulé jusqu’alors, se trouvent tout-à-fait taries ; que le ciel semble devenir d’airain, & que la terre de fer, selon l’expression de l’Ecriture, & qu’on espère plus absolument que de mourir : voylà une main secourable qui vient s’étendre du plus loin, sur cette ville infortunée ; M. Law, plus grand par son esprit et par ses vertus, que par ses dignités et par sa fortune, y fait tomber une assistance, digne de la grandeur de sa charité ; il envoie à Mrs les Échevins une aumône de 100 000 livres pour les distribuer aux pauvres…. » (cf. Publication # 15).
Le Père Giraud
« Le 24, à mesure que la force du venin pestilentiel se soutenoit toujours la même dans la ville, elle faisoit chaque jour de nouveaux progrès dans le terroir. Cette propagation du mal donnoit lieu à ceux qui s’étoient conservés jusqu’alors de craindre de pouvoir se conserver jusques à la fin. On se persuadoit même que cette peste, la plus maligne de toutes celles qui avoient affligé Marseille, n’épargneroit personne, et qu’on en seroit tous frappés les uns après les autres. La plus part envioient le bonheur de ceux qui étoient morts les premiers, parce qu’ils n’avoient pas essuyé les craintes, les alarmes et les horreurs auxquelles ils étoient exposés la nuit et le jour.
« D’ailleurs, la misère extrême et la calamité des pauvres qui n’avoient déjà plus de ressource faisoient apréhender aux plus aisés de mourir de faim, on n’entendoit partout que plaintes, que soupirs, que gémissemens. (...)
« Nonobstant le peu de succès des feux publics qu’on avoit fait dans la ville le 2 août, ceux qui s’étoient réfugiés dans le terroir n’avoient pas laissé d’en faire presque tous les soirs devant leurs bastides, si quelqu’un alloit à la ville, on ne manquoit pas de le parfumer à son retour. Prévenus que ces feux et ces parfums étoient capables de dissiper le venin pestilentiel, on avoit consumé toutes les herbes odoriférantes du terroir, de là qu’on en vendoit dans la ville un petit fagot du poids d’une vintaine de livres jusques à six francs. Quand on vit que tous ces feux et tous ces parfums n’empêchoient pas que la peste se répandit dans tout le terroir comm’elle avoit fait dans la ville, on s’en désabusa, on cessa d’en allumer et de brûler des parfums, on se contenta de veiller sur soi-même, on ne reçut plus rien qu’avec les précautions nécessaires, chacun se défiait de son voisin et se tint exacte-ment enfermé chés soi. Aussi, c’étoient là les seules précautions salutaires, tout le reste n’avoit été qu’amusement »