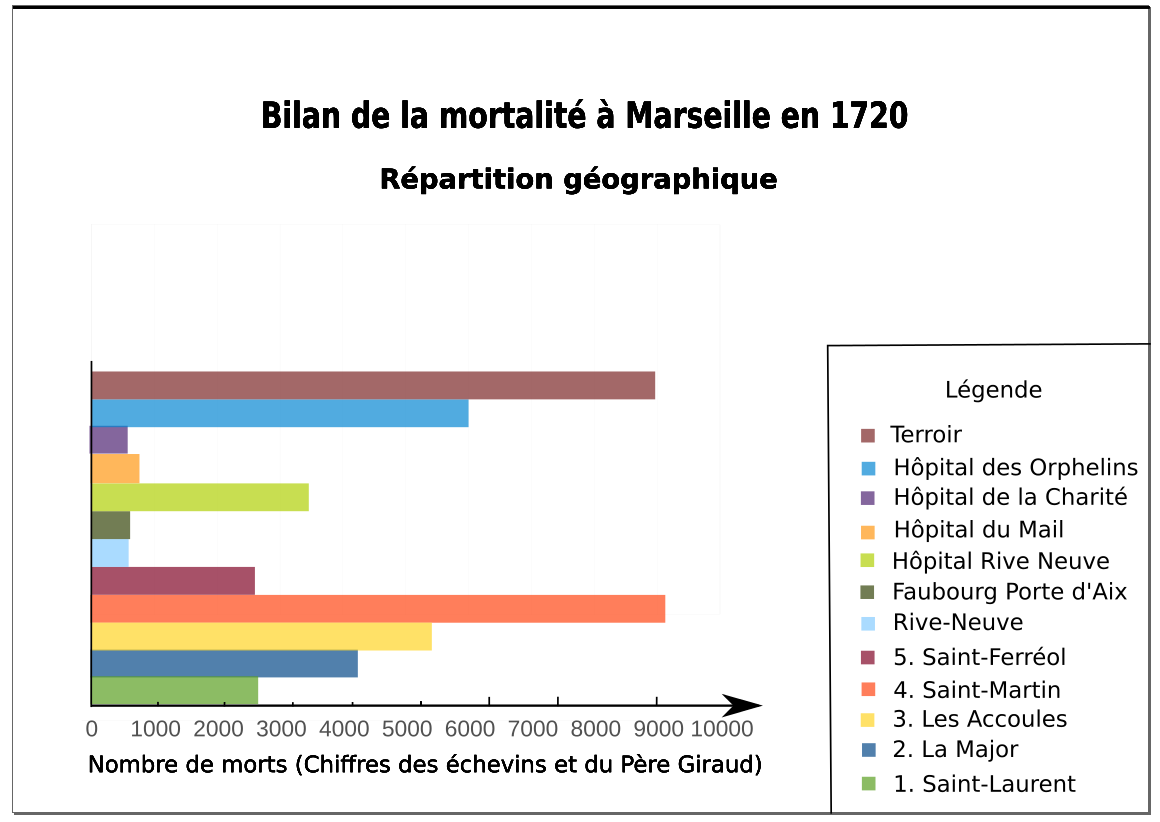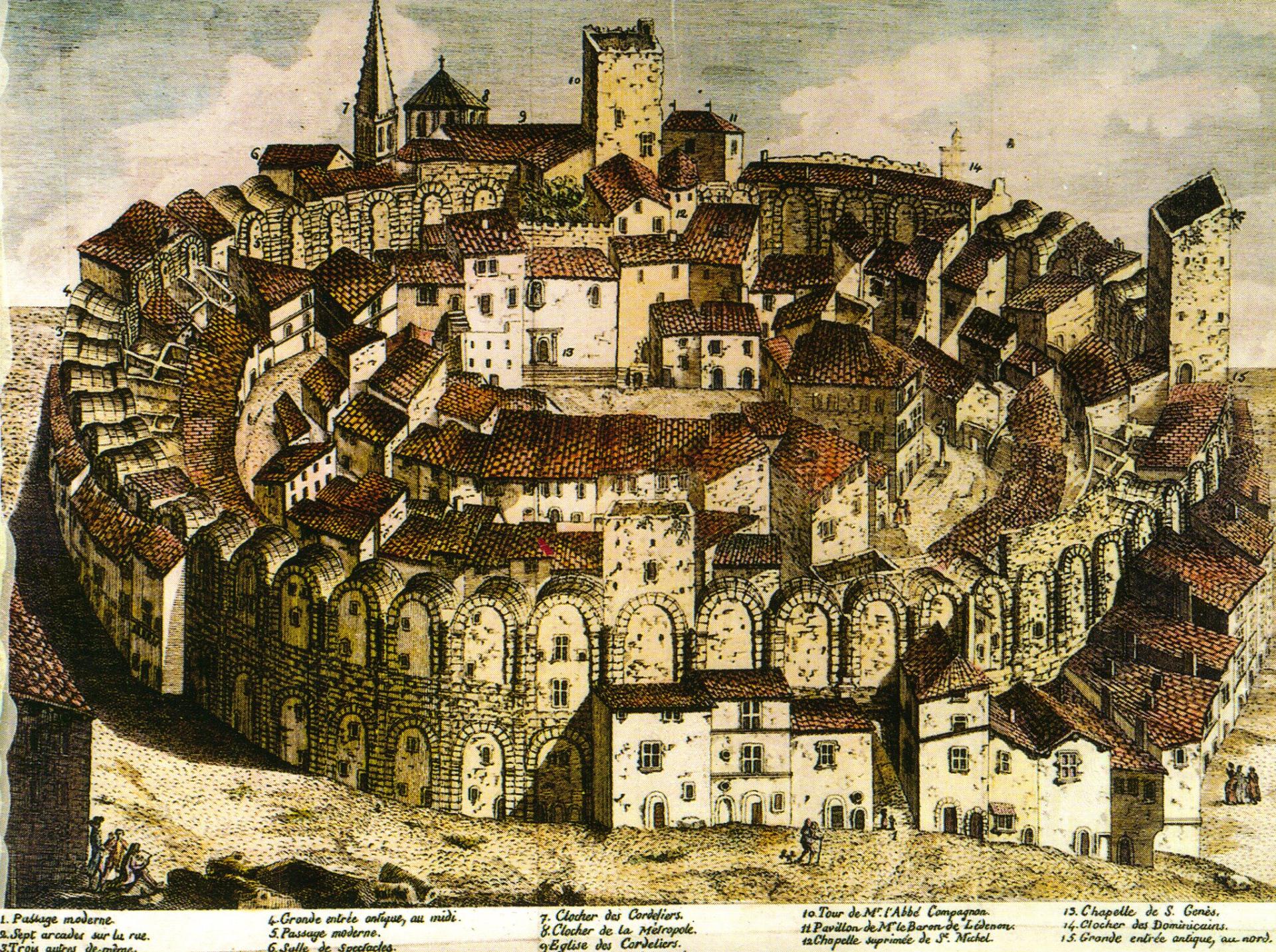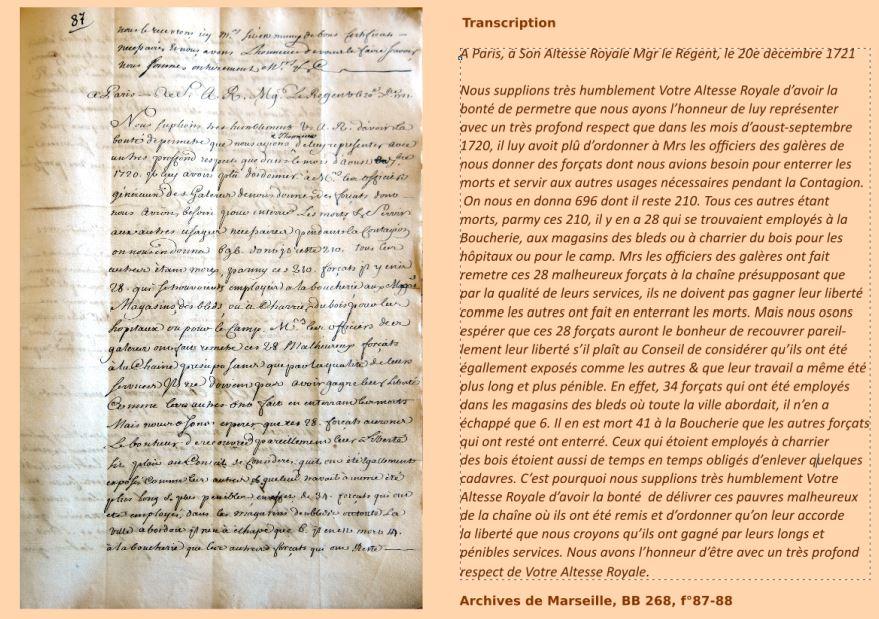Carte des sites préhistoriques connus dans le bassin de Marseille
Réalisation Kamisphère (c) Musée d'Histoire de Marseille / Ville de Marseille 2013